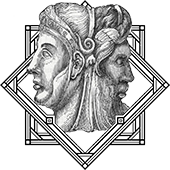Claude Breuillot
Psychanalyste
Docteur en Psychologie Clinique
Membre du laboratoire de Psychologie de l’université de Besançon
Expert Judiciaire
Résumé :
Le crime fait entrer, à sa seule évocation, sur une autre scène. Cassure de la temporalité : c’est le temps de l’acte extrême, hors temps et hors scène, qui a ensuite à être qualifié par le discours social. Le crime est dit par le droit et le collectif. La question est de déterminer comment la psychanalyse peut en approcher.
Propos liminaires
Les occurrences réelles, symboliques et imaginaires, en termes de signifiés, du concept de limite, ne manquent pas de solliciter nos réflexions : le seuil1 introduisant la notion de résistance, la barrière2, les structures de bord3, le littoral, le pas4, la charnière,… « […] la question de la frontière entre le normal et le pathologique [s’entend] à travers celle du seuil de l’excitation […]5 » Freud parle de limite entre psychique et somatique, Lacan de bord entre logique et corps. Pour notre objet d’aujourd’hui, nous nous attacherons à souligner : « La suppression du stimulus n’est ici possible que par une intervention qui élimine pour un moment la déliaison à l’intérieur du corps, et cette intervention exige une modification dans le monde extérieur (introduction de nourriture, proximité de l’objet sexuel). 6» La faute et la cause sont les concepts-seuils de l’édifice du droit et de la morale, écrit Giorgio Agamben, dans Karman, cours traité sur l’action, la faute et le geste7.
C’est cette action qui se retrouve dans la correspondance entre le terme latin crimen et le sanscrit karman, qui désigne l’agir humain pris dans l’enchaînement infini de ses conséquences. « De la phrase : Qui legem violavit, sace resto – que celui qui a violé la loi soit sacer – ressort que sancire, c’est délimiter le champ d’application d’une disposition et rendre celle-ci inviolable en la mettant sous la protection des dieux. 8»
Le crime fait entrer, à sa seule évocation, sur une autre scène. Cassure de la temporalité
: c’est le temps de l’acte extrême, hors temps et hors scène, qui a ensuite à être qualifié par le discours social. Le crime est dit par le droit et le collectif. La question est de déterminer comment la psychanalyse peut approcher la cause, le mis en cause, « du latin causa dont dérive, dans les langues romanes, le terme chose, ce qui est en question, en cause entre les hommes 9».
« Le psychanalyste ne prendra pas la place de l’acolyte. Mais il convient d’accorder un intérêt théorique plus grand encore à une série de techniques auxiliaires de l’esprit, qui visent évidemment à distraire l’attention de l’auditeur.10» en référence à l’attention flottante.
Peut-on être neutre en se rapportant à la neutralité bienveillante freudienne qu’il est urgent de reprendre à notre compte dans notre quotidienneté dite moderne ? Qu’est-ce que la bien-veillance arrimée aujourd’hui, ou inféodée, non sans effets, à la psychologie dite positive ? Quelles sont ses limites ? Ce positivisme rejoint régulièrement par déplacement la bienveillance et la Miséricorde11 à la croisée du religieux. Du latin vigilare : « veiller, être éveillé, être sur ses gardes, attentif », dérivé de vigil : « éveillé, vigilant, attentif », comme substantif : « garde de nuit, veilleur.» Pour Montaigne, la veille « exerce une surveillance sur quelque chose ou sur quelqu’un 12» Veiller à consiste à s’occuper activement de quelque chose, y donner tous ses soins ou encore : « rester constamment en éveil pour intervenir en cas de besoin.13 »
« Le paradoxe de la situation de l’analyste c’est la difficulté où il est de trouver une position dont l’équilibre ne soit pas sans cesse menacé entre l’observation et la participation. Aucune science d’observation ne survivrait aux conditions où l’analyste s’est placé. Il doit à la fois observer et savoir utiliser les moyens du raisonnement scientifique pour tirer profit de son observation ; il doit aussi participer, être impliqué émotionnellement, mais aussi rester neutre. 14»
Quant à la neutralité de l’analyste, « elle n’est pas seulement ce qui laisse jouer plus librement d’autres facteurs, mais elle est, par elle-même, un autre facteur, un facteur essentiel pour la création du transfert.15 » écrit Jean Laplanche.
« Les impressions que nous avons recueillies au cours de nos expériences psychanalytiques nous autorisent à admettre que tous les processus d’excitation qui s’accomplissent laissent des traces durables qui forment la base de la mémoire, des restes qui sont des souvenirs et qui n’ont rien à voir avec la conscience. Les plus intenses et les plus tenaces de ces souvenirs sont souvent ceux laissés par des processus qui ne sont jamais parvenus à la conscience. Nous savons, par exemple, que les processus psychiques inconscients sont « intemporels ». Cela veut dire qu’ils ne sont pas disposés dans l’ordre du temps, que le temps ne leur fait subir aucune modification, qu’on ne peut pas leur appliquer la catégorie du temps. 16»
« Du discours que l’analysé prononce et que l’analyste écoute distraitement, son attention flottante à la surface des significations apparentes, il rêve les fantasmes qu’il nomme dans un autre registre, celui d’un discours performatif – performance de l’interprétation. 17»
L’attitude de neutralité qu’on attend de l’analyste suppose que les valeurs religieuses, morales et sociales de celui-ci n’influencent pas la cure. Ce précepte acquiert de l’importance dans la mesure où la technique psychanalytique s’éloigne des méthodes suggestives18.
Déterminisme ou prédication ?
L’asocialité, le vol, la délinquance ont été les terrains de recherche de nombreux psychanalystes de Freud en passant par Winnicott.
« Les sensations de plaisir et de déplaisir, par lesquelles se manifestent les processus qui se déroulent à l’intérieur de l’appareil psychique, l’emportent sur toutes les excitations extérieures ; et, en deuxième lieu, l’attitude de l’organisme est orientée de façon à s’opposer à toute excitation interne, susceptible d’augmenter outre mesure l’état de déplaisir. De là naît une tendance à traiter ces excitations provenant de l’intérieur comme si elles étaient d’origine extérieure, afin de pouvoir leur appliquer le moyen de protection dont l’organisme dispose à l’égard de ces dernières. Telle serait l’explication de la projection qui joue un si grand rôle dans le déterminisme des processus pathologiques.19 »
Quels déterminismes impliquent les discours relevant du judiciaire ou du psychanalytique ? Quelle place prendre dans les discours entre adjectif dépréciateurs ou laudateurs ? « Il y a dans l’adjectif un aspect socio-économique. […] Il faudrait étudier les champs ou l’adjectif a une valeur marchande. 20» Paul-Laurent Assoun écrit : « La psychanalyse s’introduit sur la scène du crime et de l’incrimination avec cette idée simple et puissante, acquise depuis « l’autre scène », de l’inconscient, résultante d’un long trajet qui demande reconstitution : la réalité du crime, ce n’est pas seulement cette violence brute sur le corps, mais un événement qui touche au symbolique, de transgression. 21»
Le psychanalyste n’est pas un « représentant » de la justice bienveillant. Le sujet en place de justiciable, n’est pas un prospect. La cure ne se dirige ni avec ni pour un idéal ou un but.
« Le sujet amoureux couvre l’autre, le petit autre, d’adjectifs laudateurs. C’est une polynymie
qui est bien connue de la théologie ou de la pratique religieuse. On trouve ça, par exemple dans
les litanies de la Vierge ; mais aussi, ou finalement, ce même sujet amoureux, qui est insatisfait, de ce chapelet d’adjectifs qui sent le langage déchirant dont souffre la prédication, qui sent que la prédication n’arrive pas à rendre compte de l’objet aimé, en vient à chercher un moyen langagier pour pointer ceci : à savoir que l’ensemble des prédicats imaginables de l’objet aimé ne peut atteindre ou épuiser la spécificité absolue de cet objet […] Le sujet amoureux passe brusquement de la polynymie à l’anonymie.22»
L-Ö-F pare-fait ou L-Ö-F mot-laid ?
Le littoral, une des figures du littéral. « La question de la figure, écrit Jacques Rancière, c’est quel type d’usage du langage produit un écart par rapport à l’usage consensuel du langage et de la représentation sensible.23 »
Le psychanalyste n’a-t-il pas sa place dans les institutions ? Comment apprécier sa frilosité à trouver/créer sa place dans la Cité ?
Freud, comme le rappelle Paul-Laurent Assoun24, ne perd pas l’occasion de s’impliquer dans les débats de la criminologie de son temps, intervenant « en tiers », entre le monde des neurologues et psychiatres et le pouvoir judiciaire. « La psychanalyse, écrit Paul-Laurent Assoun faisant la part entre symptôme et délit, entre victimisation et transgression, intervenait donc en position de tiers ou d’arbitre avec les prérogatives, au reste non-négligeables mais limitées, d’expert-témoin. 25»
La technique moderne de cuisson à basse température a été mise au point dans le cadre de la vogue de la gastronomie moléculaire : elle est présentée pour la première fois sous le nom d’« œuf parfait » en 1987 par le physico-chimiste Hervé This dans le cadre de ses travaux sur L-Ö- F.
Le « seuil » : cet espace, ce temps, à partir desquels peuvent être pensé la position de l’expert judiciaire qui œuvre dans l’entre ou l’antre polysémiques.
Si la température est trop basse, l’L-Ö-F ne coagule pas, si elle est trop haute, on obtient la consistance de L-Ö-F mot-laid.
L’histoire à déchiffrer nous renvoie à l’Onsen-tamago du japonais (onsen) la source chaude et (tamago) œuf, littéralement œuf de source chaude est à la limite entre dur et mollet, cuit dans une eau thermale ou dans la vapeur d’une source thermale chaude mais en dessous du moment crucial, le point d’ébullition.
« La magie, c’est la vérité comme cause sous son aspect de cause efficiente. 26» Soulignons l’importance du choix des signifiants dans leur effet de trou et de rupture dans la chaine signifiante langagière, entre sujet de l’énoncé et sujet de l’énonciation.
L’expert judiciaire et la demande judiciaire
Freud écrit à la demande de juristes deux textes : « La psychanalyse et l’établissement des faits par voie diagnostique » (1906) et « L’expertise de la Faculté au procès Halsmann » (1931) qui nous instruisent aux demandes de la Justice et au recours à l’expertise psychiatrique (voire psychanalytique). Si certains psychanalystes eurent très tôt fonction de médecin expert (ainsi Sandor Ferenczi auprès de l’armée pendant la première guerre mondiale ou auprès du tribunal de Kassa pour l’examen médico-légal d’un homosexuel en 1918), l’inventeur de la psychanalyse fut rarement sollicité par les tribunaux.
En 1906, c’est un professeur de droit pénal à l’université de Vienne, Löffler, qui demande à Freud de traiter devant les étudiants de son séminaire d’une innovation de l’instruction empruntée aux nouvelles méthodes de la psychiatrie : L’établissement des faits par voie diagnostique et la psychanalyse paraîtra la même année dans les Archiv für
Kriminalanthropologie und Kriminalistik 27. En 1931, un autre professeur de droit de l’université de Vienne, Josef Hupka, demande à Freud d’appuyer la demande de révision d’un procès criminel, l’affaire Philipp Halsmann : telle est l’origine des trois pages intitulées L’expertise de la Faculté au procès Halsmann, publiées peu après28.
Dans le cadre d’une enquête pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, il m’est demandé, par le Procureur de la République, de répondre aux questions ci- après, notamment :
- Relever les aspects de la personnalité de la victime, dire si elle présente des troubles ou anomalies susceptibles d’affecter son équilibre psychique et indiquer son niveau d’intelligence.
- Analyser les circonstances et le contexte de la révélation : rechercher les facteurs éventuels de nature à influencer les dires de la victime.
- Décrire le retentissement éventuel et les modifications de la vie psychique depuis les faits en cause. Peuvent-ils être évocateurs d’abus sexuels?
- Faire toute remarque utile sur le récit de la victime et son évolution depuis la révélation sous l’angle psychologique et psychopathologique.
- La victime présumée peut-elle être considérée comme vulnérable au sens juridique du terme. Si tel est le cas, déterminer si cette vulnérabilité est apparente.
La justice entretient une relation étroite mais particulière avec le pouvoir politique. Séparée de lui conformément au principe de la séparation des pouvoirs, la Justice agit dans le cadre des lois. Son indépendance est régulièrement questionnée comme l’est sa place au sein de l’échiquier institutionnel. Il faut ici se rappeler que pour Locke et Montesquieu, la puissance de juger est une puissance associée à la fonction exécutive mais que compte tenu de sa fonction – la garantie de la propriété privée et de la liberté – elle doit bénéficier d’un statut qui la protège d’interférences extérieures. Le long désintérêt de la science politique pour la justice invite à revenir sur ce qui se joue dans le processus de différenciation des savoirs juridiques, singulièrement dans la césure toujours plus marquée entre un droit public et un droit privé, selon qu’ils relèvent du droit public (politique) ou du droit privé (non politique). Le droit public est alors défini comme « un droit du pouvoir […], celui qui règle l’organisation du pouvoir […], ce qu’on pourrait appeler l’architecture juridique du pouvoir », par opposition au droit privé qui, comme son nom l’indique d’ailleurs très clairement, « est celui qui règle les rapports entre les simples citoyens : rapports familiaux, rapports de propriété, de commerce, etc. 29»
Les ministères régaliens au sens le plus strict concernent l’armée, la police et la justice. Régalien, du latin regalis « royal » se dit, au sens historique, d’un droit attaché à la royauté, ou qui, en république, manifeste une survivance des anciennes prérogatives royales. (Le droit de grâce du président de la République, en France, est un droit régalien, comme celui de battre monnaie.)
Astarté (15 ans)
L’une des plus anciennes divinités connues se nommait Inanna, ou encore Ishtar. Elle est apparue, il y a un peu plus de 5 000 ans, au pays de Sumer, dans le sud de l’Irak actuel, où elle était censée entretenir des relations sexuelles avec les rois successifs de la région qui étaient considérés à la fois comme ses grands prêtres et ses amants. Quelques siècles plus tard, on retrouve cette déesse au Liban, l’ancienne Phénicie, où elle est appelée Astarté.
Je la reçois en place de plaignante, concernant cinq chefs d’inculpation :
- Proxénétisme aggravé : victime mineure de 15 ans prévu par ART.225- 7-1. ART.225-5 du Code pénal et réprimé par ART.225-7-1, ART-225-20, ART.225-21, ART-225-24, ART.225-25, ART.131-26-2 du Code pénal,
- sollicitation d’un mineur de 15 ans par un majeur pour la diffusion ou la transmission de son image A CARACTERE PORNOGRAPHIQUE prévu par ART.227-23-1 du Code pénal et réprimé par ART.227-23-1 AL.2, ART.227-29, ART.227-31 , ART.227-31-1 du Code Pénal.
- Agression SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS prévupar ART.222-29-1 , ART.222-22, ART.222-22-2 Code Pénal et réprimé par ART- 222-29-1 , ART.222-44, ART-222-45, ART.222-47 AL.I ,AL.3, ART-222-48, ART.22248-1 AL.I , ART.222-48-4, ART. 131-26-2 C.PENAL.
- DIFFUSION DE MESSAGE VIOLENT, PORNOGRAPHIQUE OU CONTRAIRE A LA DIGNITE ACCESSIBLE A UN MINEUR prévu par ART.227- 24 C.PENAL et réprimé par ART.227-24, ART-227-29, ART.227-31, ART.227-
31-1 C.PENAL.
– VIOL COMMIS SUR UN MINEUR DE 15 ANS prévu par 20, ART- 222-23 AL. 1 , ART.222-22-2 C.PENAL et réprimé par ART.222-24 AL.I, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-48-1 AL. 1 , ART.222-48-4, ART.131-26-2 C.PENAL.
Astarté se présente comme une adolescente de son âge, aux habits amples lui permettant, imperceptiblement, de masquer les formes de son corps. En fonction de l’avancée de l’expertise et d’une certaine détente liée à la libération de sa parole, Astarté donne plutôt à entendre les énoncés d’une petite fille, accrochée à un monde idéal, telle une princesse attendant le prince charmant, devenu son idole.
Astarté vivra dans une forme d’excitation permanente, incestueuse, entretenue familialement. Elle se souvient prendre ses bains avec son frère qui avait déjà 8 ou 9 ans. Elle se masturbe frénétiquement, énonce-t-elle, depuis ses
7 ans, signe d’une angoisse envahissante et d’une quantité psychique d’excitation non symbolisée. Ces pratiques masturbatoires sont souvent auto- calmantes.
Les phénomènes dissociatifs affectent la pensée d’Astarté. Au moment des faits, Astarté est hors du contrôle parental, dans une sorte d’errance où le
cannabis vient soutenir la fragilité psychique de cette jeune adolescente. Elle manque d’un lieu thérapeutique pour symboliser ses expériences de subjectivation.
Ses choix sont influencés par son sentiment abandonnique et le traitement médical qui affaissent ses mécanismes de défense.
Astarté énonce avec détails avoir été violée, par 6 enfants, à l’école, dans les toilettes, en Cours Préparatoire : elle a 5ans. Elle tente, après-coup, d’exister par des scénarios ordaliques de mise en danger. Astarté subit l’adolescence dans un premier temps. On peut même dire que cela lui « tombe dessus », d’où l’importance paradigmatique de la chute mise en scène dans les pratiques ordaliques. Le phénomène de chute rend compte du travail psychique auquel le sujet ordalique est confronté. Il essaie, entre autres, de démêler les restes en s’exposant pour réexpérimenter un statut de survivant, c’est-à-dire, afin d’interroger sa rencontre avec des vécus anciens de mort psychique.
La scène ordalique reflète l’histoire d’un sujet et la manière dont il essaie d’advenir, au risque de rencontres hasardeuses avec des figures influençant ses repères.
Les influenceurs sur la toile, tel le mis en cause, viennent scintiller de leurs paillettes imaginaires.
Si étymologiquement le mot « prostitué » provient du latin prostituere, « placer devant, exposer à la vue » et suppose que la présence et la monstration sont les mots-clés pour définir ce qui relève de la prostitution, l’absence et le manque sont au cœur de la problématique prostitutionnelle. Pour Astarté, son agresseur présumé, en place d’idole, idéalisé par 40.000 followers fera figure du sauveur.
Celui-ci troquera des stupéfiants contre des pratiques sexuelles en échange de rétribution. Ces jeunes adolescentes, sous l’emprise inconsciente de leurs dettes symboliques, imaginaires et réelles, illuminées par la figure du maître, sont disposées à devenir la proie de la Jouissance qui rencontre leurs fantasmes. La compétition identificatoire imaginaire entre pairs – à celle qui sera
la préférée sur la toile – dans une réalité virtuelle aux confins d’effets réels dans le corps, fera le reste.
L’influenceur abusera de la situation en la menaçant de l’abandonner ou en la menaçant physiquement. Le sentiment de culpabilité inconscient et la honte feront dire à Astarté qu’elle était amoureuse. A la différence de l’enfance, l’adolescence constitue un moment d’appropriation subjective qui renforce le sentiment d’être le seul responsable de ce qu’on vit intérieurement.
Aujourd’hui, elle éprouve une colère sans nom. Elle découvre qu’elle n’était qu’un objet sexuel monnayable et consommable, au profit de celui qui l’instrumentalise, le mis en cause, et de ses mécanismes psychiques inconscients endogènes. Même si elle en avait quelques subsides, le traumatisme psychique est présent.
Le moment de conclure
Quand je dis : « L’enfant est parlé avant d’être parlant. », est-ce un biais cognitif en référence au comportementalisme, ou une transmission psychique inconsciente permettant l’élaboration des instances symboliques et imaginaires, respectivement, l’Idéal-du-moi et le Moi-Idéal ?
Soumis à notre quotidienneté troublée et à son accélération, l’aphorisme lacanien : L’inconscient, c’est la politique, laisse émerger son indicible Vérité, lové aux limites de l’État et de ses ministères. La géopolitique, les limites des États, leurs frontières sont particulièrement attaqués au Liban ou en Europe.
La passion de savoir et celle de l’ignorance sont la seule et même face d’une bande de Möbius, « avec ses propriétés complètes, et particulièrement celle d’être unilatère […] – à savoir qu’un sujet infiniment plat s’y promenant peut, partant d’un point quelconque extérieur de sa surface, revenir par un chemin extrêmement court, et sans avoir à passer par aucun bord, au point envers de la surface dont il est parti – […] 30». Celle de savoir s’appuie souvent sur de nouvelles formes de fanatismes dont les experts autoproclamés alimentent les relais politiques et économiques de l’État aux territoires. Nous entendons l’équivoque de cette jouissance à vouloir notre bien.
« L’avènement de l’Evidence Based Practice ou la pratique basée sur les preuves sera le fer de lance de l’idéologie scientiste réductionniste à la recherche de rationalisme. 31»
L’idée de justice est parfois exprimée par le désir de l’action juste, c’est-à-dire le vœu du discernement de l’action appropriée, au plus près du désir du sujet, du justiciable, du choix de ce qu’il est bon ou bien de faire, en rapport à la morale, aux idéaux, des choix pour une grande part inconscients qui partagent le sujet entre pulsions de vie et de mort, principe de plaisir et de réalité, et l’empêchent d’ordonner son existence. « L’institution judiciaire est seule à pouvoir décider de ce qui est juste ou non. 32» Se faire justice soit même ou demander justice convoquent l’événement non désiré, l’événement insupportable, l’événement par la souffrance indicible singulière, au cas-par-cas, qu’il engendre qui pose, souvent dans l’après-coup, la question de la justice et des espoirs déçus. En effet, il n’est pas déterminant psychiquement qu’une recours à la justice permette une guérison ou une quelconque réduction de la souffrance, au regard des normes et des influences immanentes. Pour exemple, trois associations – Le Planning familial, Sidaction et SOS homophobie – impliquées, prétendent-elles, dans la
promotion de la santé sexuelle et reproductive, la lutte contre les violences de genre et contre les discriminations LGBTIphobes, ont décidé d’assigner l’État en justice. Le 2 mars 2023, les associations réunies sous la bannière Cas d’école ont annoncé avoir saisi le tribunal administratif de Paris « pour demander l’application pleine et entière de la loi de 2001 relative à l’éducation à la sexualité (ES) des élèves, tout au long de leur scolarité ». La psychanalyse n’engendre pas de nouvelles normes, assignant le sujet dans un nouvel idéal. « La position du juge s’en retrouve transformée en s’identifiant désormais à celle d’un interprète (au sens de l’opération psychanalytique), comme le préconise Pierre Legendre. 33»
Étendre notre champ de réflexion à l’analyse des systèmes d’influence, ce serait invoquer une critique de la neutralité.
La cindynique et les sciences du danger viennent attaquer les processus de pensée par falsification, en substituant les cause et les effets..
Les influenceurs déterminent, vectorisent la pensée, la pénètrent, voire la pervertissent.
Le concept de biais cognitifs34 serait la nouvelle version néolibérale de la gestion des risques et des émotions. La Sociologie et l’Économie, à l’Université, adossées aux sciences cognitives venant légitimisées scientifiquement leurs travaux, viendraient-elles en place d’influenceuses ?
« L’esprit – même quand son fond n’est pas tendancieux, mais intéressant du seul point de vue de la pensée théorique – n’est en somme jamais totalement dépourvu de « tendance » ; il possède un second objectif qui est de favoriser la pensée en la grossissant et de la préserver de
la critique. Il manifeste ici à nouveau sa nature primitive en s’opposant à cette force inhibitrice et restrictive qu’est le jugement critique.35 »
Emmanuel Peterle, économiste, Maître de conférences à l’Université de Franche-Comté, Coresponsable du parcours Ingénierie Économique (mention Économie de l’entreprise et des marchés) prétendait lors d’une conférence en 2024, je cite : «La justice, pilier de notre société, est-elle exempte des biais cognitifs qui influencent nos choix quotidiens ? Une opportunité unique de découvrir le croisement fascinant entre droit, économie comportementale et psychologie, et d’appréhender comment notre système judiciaire peut être façonné par ces influences subtiles. 36» Le fil associatif, nommé en informatique, hypertexte, nous permettra la découverte des enjeux politiques de ladite Économie Comportementale37, qui influencent les gouvernements : « […] une extension pourrait consister à représenter le procès sous la forme d’un tournoi dans lequel les parties en conflit cherchent à s’approprier une rente, représentant la valeur du jugement. […]38 »
Les liens entre Science et vérité seront analysés par Jacques Lacan. Dans une tribune publiée le 22 octobre dans l’Obs, 60 psychiatres et psychologues réclament que la psychanalyse soit exclue des tribunaux, mais aussi des universités. Cette tribune a été lancée à l’initiative de la réalisatrice Sophie Robert, qui s’est notamment fait connaître avec son film documentaire concernant l’autisme : Le Mur. Parmi les signataires de la tribune, on compte le Pr Franck Ramus, Directeur au CNRS, membre du Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique, également membre du Conseil Scientifique de l’Education Nationale. Le 10 janvier 2018, Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation, crée Le conseil scientifique de l’éducation nationale, dit « au service de la communauté éducative ». Celui-ci composé, selon le ministère , d’une vingtaine de personnalités reconnues travaillant dans différentes disciplines scientifiques, peut être saisi sur tous les sujets afin d’apporter des éclairages pertinents en matière d’éducation. J-M Blanquer écrit avec emphase, le 12 mars 2018 : « Le
conseil scientifique va éclairer la décision politique sur les grands enjeux éducatifs de notre temps. ».
J’écrirai : « Nous reconnaissons un raz-de-marée pandémique des sciences cognitives. L’imagerie cérébrale devient le « faire » de lance de ce néo-savoir sur l’apprentissage et il faudra que ça se sache. Déjà, en février 2006, Gilles de Robien, alors ministre de l’Éducation nationale, formulait le vœu de développer les sciences expérimentales cognitives. Pas seulement aux fins de trouver les meilleurs outils pour apprendre, mais surtout avec la croyance très particulière de pouvoir enfin résoudre l’énigme de la fabrication de nos pensées. 39» La croyance aurait la forme du pré-jugé, « l’opinion considérée comme vraie, la doxa.40 »
« La position du psychanalyste ne laisse pas d’échappatoire, puisqu’elle exclut la tendresse de la belle âme. 41»
Dans une étude analysant les données issues de l’ensemble des travaux existants sur le sujet, des chercheurs de l’Inserm et de l’ENS-PSL montrent que « non seulement les biais sont présents même dans les processus cognitifs les plus simples, chez l’humain et chez l’animal, mais aussi que leur intégration dans des algorithmes d’apprentissage renforceraient leurs performances 42». Ces travaux, parus dans Trends in Cognitive Sciences suggèrent que ces biais à l’aune du comportementalisme, pourraient être initialement un avantage évolutif très ancien, aux dépends de la méprise possible du sujet-supposé-savoir, en se trompant de signifiants, ce qui serait, de la part du psychanalyste, le plus impardonnable.
« Avant d’essayer de définir les paramètres de la situation anxiogène, paramètres qui ne peuvent se dessiner qu’à partir des problèmes propres à l’identification, on peut se poser une première question d’ordre plus descriptif qui est celle-ci : qu’entendons-nous quand nous parlons
d’angoisse orale, de castration, de mort ? Essayer de différencier ces différents termes au niveau d’une sorte d’étalonnage quantitatif est impossible, il n’y a pas d’angoissomètre.43 »
Si l’acte psychanalytique44 pose de façon radicale la question de la formation du psychanalyste, au détour des formations de l’inconscient, c’est de la parole du sujet, portant la lourde tâche de construire les chaînes signifiantes qui tissent son inconscient, que se forme le psychanalyste.
1 Le seuil est à entendre ici en lien à la quantité d’énergie supportable, de l’éconduction, de la résistance au niveau des barrières de contact, dans la théorie freudienne. Freud, S. (1895), « L’expérience vécue de satisfaction», Projet d’une psychologie, Lettres à Fliess, Édition complète, PUF, 2006, P. 624-629.
2 « Les deux barrières qui garantissent le niveau constant du moi ». Freud, S. (1895), « Essai de présentation des processus ᴪ normaux », Projet d’une psychologie, Lettres à Fliess, Édition complète, PUF, 2006, P. 674-675.
3 Lacan, J. (1968-1969), Le Séminaire, livre XVI, D’un Autre à l’autre, Seuil, 2006,P. 229. « La pulsion désigne à soi seule la conjonction de la logique et de la corporéité. (…) intervient dans la pulsion ce qu’on appelle en topologie une structure de bord. »
4 Le péché, c’est le faux-pas, selon l’étymologie rappelée par Giorgio Agamben. Ouvrage cité en référence.
5 Golse, B. (2001), L’enfant excitable. Système pare-excitation, système pare-incitation, Enfances & Psy 2001/2 (no14), P. 49-56.
7 Agamben, G. (2018), Karman. cours traité sur l’action, la faute et le geste, L’ordre philosophique, Seuil.
8 Ibid., Agamben, G. (2018), Karman. cours traité sur l’action, la faute et le geste , P. 30.
10 Feud, S. (1905), Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient.
11 On pourra lire « La Miséricorde : Notion fondamentale de l’Évangile. Clé de la vie chrétienne », de Walter Kasper, Théologien et cardinal catholique. Notamment le chapitre intitulé : « Empathie et compassion comme nouvelle approche ». La Miséricorde porteuse comme signifiés de magnanimité , clémence , indulgence.
12 Montaigne, M. de, Essais, I, 23, Éd. P. Villey et V.-L. Saulnier, P. 111.
13 Dammartin, H. de, Foulque de Candie, éd. O. Schulz-Gora, 6101.
14 Viderman, S. (1970), « Les diffractions du milieu analytique », La construction de l’espace analytique, Tel Gallimard, 1982, P. 46.
15 Laplanche, J. (1979-1983), Problématiques V. Le baquet. Transcendance du transfert, Paris, Puf, 1987, p. 204- 205, 273.
16 Freud, S. (1920), Au-delà du principe de plaisir.
17 Viderman, S. (1970), « Le langage dans le champ de l’analyse », La construction de l’espace analytique, Tel Gallimard, 1982, P. 66.
18 Laplanche, J., Pontalis, J.-B. (1967), Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, Puf, 1994, P. 266-267.
19 Freud, S. (1920), Au-delà du principe de plaisir.
20 Barthes, R. (1978), « L’agression par l’adjectif», Le neutre, Cours au collège de France, Éditions du seuil, avril 2023, Séance du 11 mars 1978, P. 146.
21 Assoun, P-L. (2004), « L’inconscient du crime. La « criminologie freudienne » », Recherches en psychanalyse 2004/2 (no 2), P. 23-39.
22 Barthes, R. (1978), « Donner congé aux adjectifs », Le neutre, Cours au collège de France, Éditions du seuil, avril 2023, Séance du 11 mars 1978, P. 151.
23 Rancière, J. (2021), « Langage et image », Les mots et les torts, La Fabrique, P. 88-89.
24 Assoun, P-L. (1997), Psychanalyse, Quadrige Manuels, PUF.
26 Ibid., Lacan, J. « Science et Vérité ».
27 Feud, S. (1906), « Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik »,26 (1). Traduction de l’allemand par
B. Féron dans L’inquiétante étrangeté et autres essais de Freud, Paris, Gallimard coll. « Folio essais », 1985.
28 Freud, S. (1921-1938), « Psychoanalytische Bewegung », 3 (I), 32. Traduit de l’allemand dans le tome 2 de Résultats, idées, problèmes, Paris, PUF, 1985.
29 La définition est de Maurice Duverger dans son Cours de sociologie politique, Université de Paris, 1961-1962, Paris, Les cours de droit, 1962, P. 138-139.
30 Lacan, J. (1961-1962), Le séminaire, Livre IX, L’identification, op.cit., Leçon du 13 juin 1962.
31 Breuillot, C. (2021), Psychanalyse et politique, de l’Un-différence au mythe de l’horizontalité : l’Asociété et ses incidences sur la subjectivation ?, École doctorale 594, Laboratoire Sociétés, Espaces, Pratiques, Temps, EA 3188, Cognition, Psychology, Linguistics, Philosophy and Education, P. 239-240. https://theses.hal.science/tel- 03547346v1
32 Ministère de la justice, « Le rôle de la justice », https://www.justice.gouv.fr/justice-france/fondements- principes/role-justice
33 Chaumon, F. (2004), « Le sujet du droit n’est pas le sujet de la psychanalyse », Vie sociale et traitements, 2004/4 (n°84), P. 24-28. Franck Chaumon est ancien psychiatre des hôpitaux et psychanalyste.
34 Biais cognitifs : La répétition et ses enjeux, reconnue, dans l’après-coup freudien par les partenaires de l’équipe à l’UQAM, soit la Chaire de recherche du Canada sur l’injustice et l’agentivité épistémique. Institut des sciences cognitives et le Laboratoire de recherche culture, identité et langue (CIEL).
35 Feud, S. (1905), Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient.
36 Conférence du 11 janvier 2024.
37 Développements de l’économie comportementale et expérimentale,9ème Conférence Internationale de l’Association française d’économie expérimentale (Nice, 2018).
38 Gabuthy, Y., Peterle, E., Tisserand, J-C. (2020), « Règle anglaise versus règle américaine d’allocation des frais de justice : une analyse expérimentale », Revue économique, 2020/6 (Vol. 71), P. 973-1004.
39 Breuillot, C. (2021), Psychanalyse et politique, de l’Un-différence au mythe de l’horizontalité : l’Asociété et ses incidences sur la subjectivation ?, École doctorale 594, Laboratoire Sociétés, Espaces, Pratiques, Temps, EA 3188, Cognition, Psychology, Linguistics, Philosophy and Education, P. 243-245. https://theses.hal.science/tel- 03547346v1
40 Lacan, J. (1967), « La méprise du sujet supposé savoir », Autres écrits, Seuil, 2001, P. 329-339.
41 Lacan, J. (1965), La science et la vérité, Les écrits. »
42 INSERM, (2022), « Certains biais cognitifs contamineraient même nos mécanismes mentaux les plus simples», Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie, Dossier, 31 mai 2022.
43 Lacan, J. (1962), Le séminaire, Livre IX, L’identification, Leçon du 2 mai 1962.
44 Lacan, J. (1967-1968), Le séminaire, L’acte psychanalytique, Éditions de l’Association Lacanienne Internationale, Hors commerce.